ÉCOLE INTEGRATIVE |«Dans notre société, l’école est le principal acteur de l’intégration»
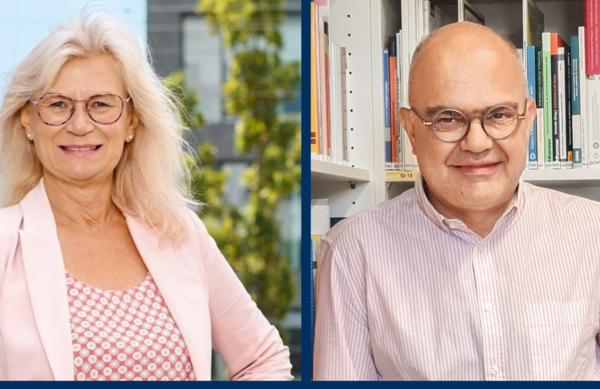
Le thème de l’école intégrative suscite des débats passionnés, également dans le corps enseignant. En principe, ce dernier est majoritairement favorable au concept, affirme Dorothee Miyoshi, de l’association faîtière Lehrerinnen und Lehrer Schweiz. Dans le cadre de notre interview, elle s’entretient avec Romain Lanners, directeur du Centre suisse de pédagogie spécialisée, sur les conditions de réussite de l’école pour tou·tes. Les deux spécialistes s’accordent à dire que la collaboration entre les écoles ordinaires et spécialisées représente l’avenir.
Madame Miyoshi et Monsieur Lanners, commençons par nous entendre sur la terminologie: préférez-vous parler d’école intégrative ou d’école inclusive? Ou avez-vous encore une autre expression?
Dorothee Miyoshi: Dans une prise de position que l’association faîtière a publiée l’année dernière, nous nous sommes mis·es d’accord, après de longues discussions, sur l’expression «école orientée vers l’inclusion», pour illustrer le fait que l’inclusion est un processus en devenir et qu’elle ne peut être considérée comme une réalité achevée. Le fait que les cantons utilisent des termes différents pour désigner les formes d’enseignement intégratives ou inclusives et en donnent une définition très variable rend les choses difficiles. C’est une situation que je déplore. Comment réaliser des enquêtes et des études si nous ne parlons pas de la même chose? Nous ne savons donc pas non plus comment les différentes écoles mettent en œuvre l’intégration ni de quelles ressources elles disposent.
Romain Lanners: Selon moi, c’est une question majoritairement théorique de savoir si l’intégration et l’inclusion veulent dire la même chose. On pourrait dire que l’inclusion va plus loin que l’intégration. «Inclusif» signifierait alors que l’ensemble des élèves est assis dans la même classe, et «intégratif» que les élèves partagent tou·tes le même bâtiment sans forcément être dans la même classe, mais en pouvant bénéficier de mesures de soutien spécifiques dans des classes plus petites. Toutefois, cette distinction n’est pas communément admise. Plutôt que de parler d’intégration, je propose donc d’utiliser l’expression «école pour tou·tes» afin de clarifier le débat.
Pour vous, c’est quoi l’école pour tou·tes?
R. Lanners: Pour moi, l’école pour tou·tes signifie que l’ensemble des élèves fréquente l’école de son quartier et y bénéficie d’un soutien. Cela peut intervenir sous différentes formes: les enfants avec ou sans mesures de soutien sont dans la même classe. Mais il se peut aussi que leurs ressources soient activées de façon séparée dans le cadre d’une classe de soutien. L’enseignement dans une classe ordinaire ne convient pas à l’ensemble des enfants ayant des besoins particuliers. À mes yeux, il est important qu’un maximum d’élèves puissent rester dans leur contexte social habituel.
Madame Miyoshi, comment se positionne le corps enseignant par rapport à cette vision de l’école intégrative?
D. Miyoshi: Dans sa majorité, le corps enseignant peut se figurer une école pour tou·tes telle que Romain Lanners vient de la décrire. L’association faîtière Lehrerinnen und Lehrer Schweiz organisera en septembre une Journée de l’éducation, lors de laquelle il en sera question. Il est important pour nous de discuter publiquement de ce thème. Dans la prise de position mentionnée, nous avons ainsi publié nos préoccupations et revendications à l’égard des politiques, pour que les conditions de la réussite de l’école orientée vers l’inclusion soient réunies.
Les enseignant·es ne sont pas tou·tes favorables à l’école intégrative ou à l’école pour tou·tes. Pouvez-vous nous en expliquer rapidement la raison?
D. Miyoshi: L’école intégrative ou orientée vers l’inclusion fait l’objet de débats passionnés au sein du corps enseignant. La majorité de nos quelque 55’000 membres est en principe favorable au concept, mais beaucoup se sentent abandonnés. Pour le personnel enseignant, il est très important que les autorités créent les conditions cadres nécessaires à un enseignement intégratif. Il a besoin de ressources et d’instruments. Il est aussi nécessaire de pouvoir changer de cadre, car il n’est pas toujours possible d’enseigner à l’ensemble des enfants dans une seule et même classe.
Si l’école intégrative est déjà souvent sous les feux des critiques aujourd’hui, cela s’explique-t-il aussi par sa conception trop large?
R. Lanners: En effet, l’intégration est souvent mal comprise dans le débat. Tout le monde a son propre avis sur le sujet. Par le passé, la communication n’a pas été bonne au sujet de la signification de l’intégration ou de l’inclusion. Il y a cette fausse idée que les élèves doivent tou·tes se retrouver dans la même classe. Or, ce cadre n’est pas adapté à de nombreux enfants. Je pense ici aux élèves présentant des troubles complexes.
D. Miyoshi: J’aimerais souligner qu’aujourd’hui, dans beaucoup d’écoles, un très bon travail est accompli sur le plan de l’intégration. Des cadres scolaires parfaitement adaptés aux besoins sont l’un des facteurs de réussite. De plus, ces écoles disposent de ressources adéquates. Des directions d’établissement scolaire capables et créatives qui soutiennent l’école pour tou·tes et contribuent par leur savoir-faire à son développement sont en outre nécessaires. Parmi les autres facteurs requis, citons l’état d’esprit positif du corps enseignant, mais aussi une bonne infrastructure. Les écoles dans lesquelles toutes ces conditions sont réunies parviennent à relever efficacement les défis.
R. Lanners: Énormément de choses de sont passées au cours de ces 20 dernières années. En conséquence de l’encouragement du modèle intégratif, il y a beaucoup moins d’élèves dans les classes spécialisées. Environ la moitié des élèves ayant des besoins éducatifs particuliers sont intégré·es dans une école ordinaire, dont 43% sont scolarisé·es dans une classe ordinaire. Toutefois, la hausse du nombre d’élèves fréquentant des écoles spécialisées doit être vue d’un œil critique.
Comment expliquez-vous cette augmentation du pourcentage d’élèves dans les écoles spécialisées?
R. Lanners: Pour ce faire, je dois remonter un peu dans le temps: contrairement à ses voisins, la Suisse a une longue tradition en matière de scolarisation séparée. La construction des premières écoles spécialisées et des premiers foyers scolaires spécialisés remonte au 19e siècle. Et cette tendance c’est amplifiée avec l’introduction de l’AI dans les années 60. À l’époque, la Confédération investissait énormément dans les écoles spécialisées. Si l’AI était entrée en vigueur un peu plus tard, nous en aurions peut-être construit moins. Tandis que les écoles spécialisées sont organisées selon le droit privé, les écoles ordinaires relèvent du droit public. Nous avons donc créé un système à deux piliers.
Et pourquoi le nombre de places en école spécialisée augmente-t-il en Suisse, malgré les efforts d’intégration?
R. Lanners: C’est une question d’offre et de demande. Notamment dans les cantons où la tradition des écoles spécialisées est fortement ancrée, les élèves qui, pour diverses raisons, ne paraissent plus «acceptables» dans l’école ordinaire sont dirigé·es vers une école spécialisée. Les arguments alors invoqués sont que cette dernière est mieux équipée, qu’elle dispose de l’infrastructure nécessaire, des connaissances spécialisées et des ressources suffisantes. Le problème est que la réintégration dans une école ordinaire est très rare par la suite. De plus, ce fonctionnement empêche le développement de l’école ordinaire.
Y a-t-il donc un risque que les écoles spécialisées mobilisent des ressources dont les écoles ordinaires auraient impérativement besoin pour pouvoir mettre en œuvre efficacement les mesures d’intégration?
R. Lanners: Les cantons utilisent les ressources disponibles de façon très variable. Dans beaucoup d’entre eux, la part de spécialistes, de la logopédiste à l’enseignante spécialisée, représente jusqu’à 25% du personnel de l’école. Avec de telles ressources, ils sont en bonne voie vers l’intégration. Dans d’autres cantons en revanche, le cadre reste séparatif. L’école ordinaire ne peut mettre en œuvre l’intégration sans ressources. Si nous voulons que l’école pour tou·tes deviennent une réalité, nous devons regrouper les deux systèmes, également parce que pour beaucoup d’élèves, notamment présentant des troubles du comportement, les structures séparatives ne sont nécessaires que temporairement.
D. Miyoshi: Il est important de disposer de suffisamment de ressources pour l’intégration. Et en effet, il est certain que si nous pouvions lier davantage les deux piliers de l’école ordinaire et de l’école spécialisée, ce serait un très bon début. Mais au-delà de cela, il me paraît essentiel de repenser toute la société.
Comment donner suite concrètement à une telle revendication?
D. Miyoshi: Au-delà de l’école, c’est notre société dans son ensemble qui est en pleine mutation. Dans sa Constitution fédérale et dans toute une série de lois, la Suisse s’engage pour une société sans barrières, que ce soit dans les transports publics, mais aussi sur le plan de la participation politique. Les personnes en situation de handicap doivent aussi avoir la liberté de choix en matière de logement et de travail.
Donc si l’école intégrative rencontre des problèmes, c’est aussi parce que notre société a trop peu mis en œuvre les changements profonds qui s’imposent?
D. Miyoshi: Oui, tout à fait. Je dirais même que, malgré certains problèmes, l’école est aujourd’hui le principal acteur de l’intégration. Dans les écoles, nous effectuons un travail titanesque en la matière. C’est trop facile de dire: «Regardez, l’école n’y arrive pas, revenons à l’ancien système.» Mieux vaudrait souligner que l’école tente d’accomplir cette tâche difficile, avec plus ou moins de succès, et nous demander que faire pour mieux y parvenir.
L’école est donc une pionnière dans le domaine de l’intégration?
R. Lanners: Votre question revient à demander si nous avons d’abord besoin d’une société inclusive ou d’une école inclusive. Je crois qu’il nous faut les deux. Si nous attendons que la société devienne inclusive pour réaliser l’école inclusive, nous attendrons longtemps. Si en revanche nous évoluons vers une école pour tou·tes, nous influencerons la société. Les élèves d’aujourd’hui sont les adultes de demain. Si les enfants apprennent à accepter l’hétérogénéité à l’école, la gérer plus tard dans la société leur paraîtra aisé.
D. Miyoshi: L’école contribue de façon extrêmement importante à la cohésion sociale de notre pays. Or, elle ne peut remplir cette mission dans un cadre séparatif. Et comme je l’ai déjà dit, il y a déjà de très bons résultats. Il faut amener les enfants à adopter cette façon de penser. Je travaille dans une classe d’intégration et constate que les enfants sont très serviables et peuvent vivre des expériences importantes.
Pour faire progresser l’école pour tou·tes, les prestations proposées dans les écoles spécialisées doivent être davantage reprises dans les écoles ordinaires: comment y parvenir?
D. Miyoshi: La collaboration entre les écoles ordinaires et les écoles spécialisées est l’une des prochaines étapes de ce projet d’intégration ambitieux. Dans les écoles, cela ne fait que commencer. Une telle collaboration place l’ensemble de l’organisation scolaire face à un très grand défi. De tels processus demandent énormément de temps et ne se réalisent pas d’un jour à l’autre. La vision est très intéressante, mais sa mise en œuvre est extrêmement difficile.
R. Lanners: Dans la partie germanophone de la Belgique, le regroupement a pris dix ans. Cette région était dotée d’un système à deux piliers, comme en Suisse. Aujourd’hui, chaque école communale a deux directeur·trices, un·e enseignant·e spécialisé·e et un·e responsable de l’école ordinaire. Pour l’accompagnement des différentes classes, il y a toujours un enseignant·e dit·e ordinaire et un·e enseignant·e en charge du soutien. Les classes sont toutes à double niveau, et l’objectif serait le triple niveau. Et il y a aussi des classes spécialisées. Grâce à la collaboration étroite sur place et aux interventions précoces qui en découlent, il y a moins d’élèves avec des besoins éducatifs particuliers.
De tels exemples existent-ils en Suisse?
R. Lanners: Genève a adopté cette structure au niveau primaire dans les classes à degrés multiples, il y a toujours un·e enseignant·e spécialisé·e et un enseignant·e dit·e ordinaire. Cela pourrait être un moyen de développer petit à petit la collaboration. Cela ne peut pas se faire du jour au lendemain: il faut un travail de préparation en amont, des formations initiales et continues ainsi que l’implication des parents et des communes.
D. Miyoshi: L’école de demain a besoin d’idées et de concepts qui l’aident à gérer son hétérogénéité croissante. Si un·e enseignant·e «ordinaire» et un·e enseignant·e spécialisé·e collaborent dans chaque classe, la prévention fonctionnera mieux. Au sein de l’association faîtière, nous avons toujours réclamé un savoir-faire en pédagogie spécialisée de la part des directions d’établissement. Mais cela n’a pas été mis en œuvre partout. De façon très générale, ces connaissances sont insuffisantes dans les écoles.
Que faudrait-il faire?
D. Miyoshi: Il est très important de former les enseignant·es dans ce domaine. Mais c’est tout sauf facile. Il serait très compliqué d’ajouter une nouvelle matière au bachelor des HEP. Et la Suisse est l’un des rares pays à ne pas former les enseignant·es dans le cadre d’un master. La formation de base devrait être dispensée dans un bachelor, après lequel les connaissances devraient pouvoir être approfondies dans le cadre d’un master, par exemple en pédagogie spécialisée. Nous avons besoin d’un grand savoir-faire dans les écoles et il serait temps de s’en rendre compte.
R. Lanners: Cela fait un siècle que nous formons séparément les enseignant·es dit·es ordinaires et les enseignant·es spécialisé·es, dans des structures différentes. Aujourd’hui, les deux cursus sont proposés au même endroit dans certaines hautes écoles pédagogiques, ce qui offre une possibilité de collaboration. Pendant longtemps, les enseignant·es se sont battu·es seul·es, mais cela ne fonctionne plus. Pour réaliser l’école pour tou·tes, il faut, au-delà de la formation, l’engagement de toutes les parties prenantes, des politiques et des autorités aux parents en passant par les directions des écoles et le personnel enseignant. Chacun·e doit y mettre du sien.
D. Miyoshi: Je souhaite un engagement de toutes les parties prenantes en faveur de l’école et de la société intégratives. D’ailleurs, nous avons pris cet engagement légalement. Le principe selon lequel il faut préférer les solutions intégratives à celles séparatives est consigné dans le concordat sur la pédagogie spécialisée. La formation inclusive est également un thème important de la CDPH, que la Suisse a ratifiée. Cet engagement me paraît encore trop faible dans la société, il s’agit de le renforcer.
Dorothee Miyoshi, née en 1964, est pédagogue spécialisée en milieu scolaire CDIP. Elle fait partie de la direction de l’association faîtière Lehrerinnen und Lehrer Schweiz et préside sa commission en charge des questions de pédagogie spécialisée. Elle travaille en outre comme enseignante spécialisée dans une classe d’intégration du degré secondaire dans le canton de Bâle-Ville.
Romain Lanners, Dr phil., né en 1970, est directeur du Centre suisse de pédagogie spécialisée.
